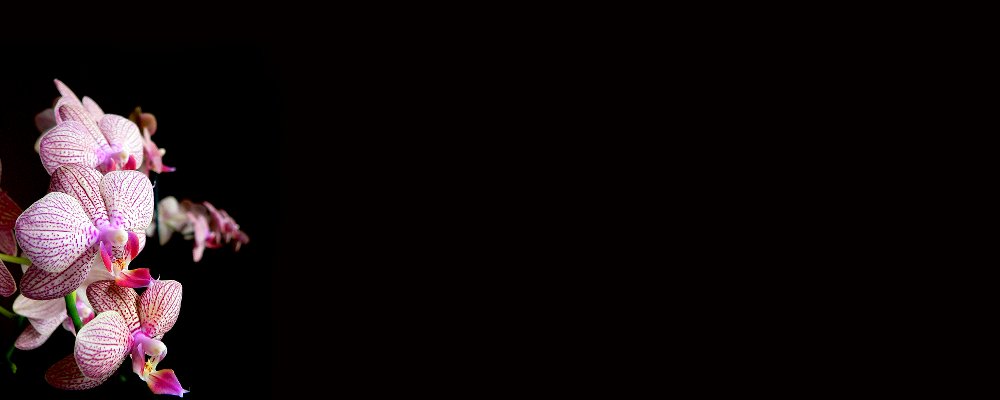Alors que l’ouragan Isabel fait tourner la tête à bien des gens aux États-Unis (et plus encore), moi ce sont les tourbillons de la vie qui m’aspirent…
J’ai encore eu une journée de folie hier. Chaque mercredi, je dois traverser la moitié de la ville alourdie du poids de mes bouquins (chers Bates et Silverman) et de mes instruments médicaux pour me rendre à un lointain hôpital et me plonger dans cette fameuse médecine clinique. C’est là que je vais apprendre à examiner un patient, mais aussi à réaliser une entrevue correctement, à rassembler tous les éléments nécessaires à la rédaction d’une bonne histoire de cas, et ultimenent en arriver à poser des diagnostics et établir des plans de traitement.
Le fameux raisonnement clinique est une tâche bien plus difficile qu’il n’y paraît et qui, pour être honnête, me fait bien peur. Aucun patient ne vit les symptômes comme un autre, ni ne les exprime de la même manière. Et chaque corps est différent… Pire que ça : une même maladie est loin de toujours se présenter de la même manière. Il faut donc savoir lire entre les lignes, interpréter. Il faut aussi pouvoir poser des hypothèses au fur et à mesure et les confronter à la réalité décrite par le patient et à celle que l’on observe à l’examen. Il faut… développer tellement de compétences que j’en ai le vertige.
Ça me fait bien rire de repenser à mon père qui me méprise d’être en médecine. Il trouve qu’il suffit d’être un perroquet et que seule la mémoire importe (cette dernière étant bien évidemment une faculté abjecte…). J’aimerais bien le voir, lui, devant un patient qui ne trouve qu’à dire “Docteur, je ne me sens pas bien…”.
Ce qui est étrange aussi, c’est que l’examen physique qu’on nous apprend à faire, je n’en ai jamais reçu de semblable. Il est d’une complétude bien insolite comparativement à cette entité pâle, distincte et éloignée que constitue “l’examen RAMQ” (ou Sécu si vous préférez, c’est la même chose).
Amusant aussi de constater à quel point il est désormais admis que la somatisation agit dans bien des cas comme processus biopsychosocial. Pourquoi ne le dit-on jamais au patient, que c’est son stress ou ses soucis qui le rendent malade ? Il ne le prendra pas mal… Tout peut se dire avec un peu de tact.
Enfin, tout ça pour dire que les années qui m’attendent m’angoissent un peu. Tout ce que j’apprends maintenant est essentiel, et je dois le savoir pour toujours. C’est la dernière fois qu’on me le montre, ça ne reviendra pas, c’est ma seule chance pour le savoir. Pour tout savoir, en fait.
Je constate aussi les risques que je prends par rapport à ma santé en m’engageant dans cette voie. Un accident est si vite arrivé, au gré des manipulations d’aiguilles, et voilà, on a le sida, la tuberculose, l’hépatite, le SRAS. Et on peut en mourir. Mourir pour son travail, quelle drôle d’idée… C’est pourtant la réalité, et elle est parfois bien éloignée du rêve. La santé mentale n’est d’ailleurs pas plus à l’abri, car il est difficile de se faire une carapace à toute épreuve, et le milieu hospitalier en est un rude. Les personnes qu’on y trouve sont désormais toujours très malades et affectées ; c’est triste, c’est dur, c’est ravageur. Beaucoup de médecin sombrent dans l’épuisement professionnel, voire le suicide - presque le double de la population en général.
Sur une note peut-être plus réjouissante, un de nos enseignants nous faisait récemment remarquer que si nous avons embrassé cette profession, c’est peut-être aussi parce que nous avons un problème avec la santé, la maladie ou la mort. Qu’un jour viendra le moment où nous seront confrontés à ce problème, et il nous faudra l’affronter. Chacun de nous aurait ainsi un rapport particulier à la santé à assumer et à élucider. J’ai trouvé ces propos très appropriés.
Voilà donc beaucoup de défis en perspective. Mais il faut arrêter de penser, et agir plutôt. Travail, quand tu nous tiens…
(Sans compter qu’hier soir je gardais encore deux petits trottineurs - du sport à l’état pur. Ne pas vouloir manger, en jeter partout, réclamer toute l’attention, monter les escaliers, les descendre aussitôt pour mieux les remonter, manger du sable, mordre l’autre, tomber, pleurer… Toute ma compassion et ma sympathie vont pour les éducatrices de garderie.)