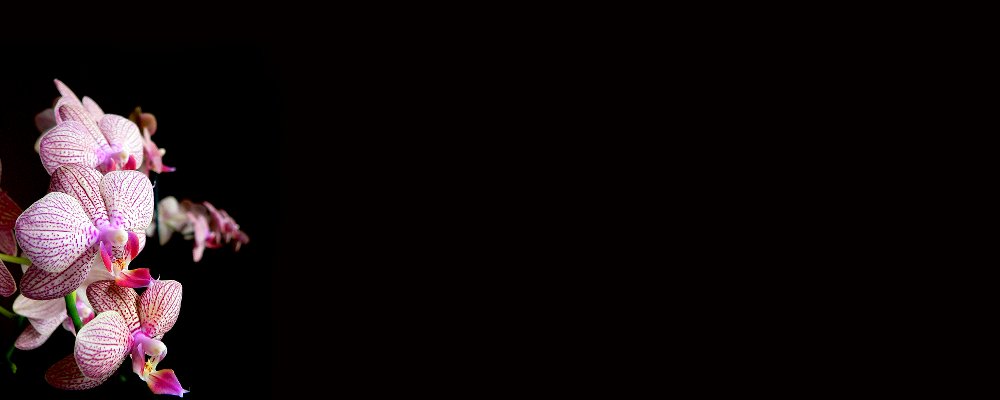Dernièrement je suis entré en contact avec une étudiante en sciences humaines qui faisait une étude sur l’intégration professionnelle des ingénieurs immigrants au Québec. Quelques mois plus tard, j’ai eu le plaisir de lire le résultat de cette étude et avec l’accord de l’auteure, je vous en présente les grandes lignes (en espérant ne pas trop dénaturer le contenu ; je tiens l’original à disposition.)
La Délégation Générale du Québec fait la publicité du Québec au niveau professionnel en se basant sur le constat qu’il manque de monde. Emploi-Québec prévoyait ainsi 640.000 emplois à pourvoir sur la période 2002-2006, la moitié venant de départ à la retraite. En effet, le Québec subit un vieillissement de population des plus rapide au monde et tout le monde s’accorde à dire que ça va créer des manques de main d’oeuvre qualifiée. Il en résulte donc depuis plusieurs années et même décennies un effort d’immigration positive se traduisant par l’entrée d’environ 40.000 personnes par an actuellement.
Toutefois l’intégration professionnelle n’est pas facile. Ainsi, en 2001, alors que le taux de chomage de la province s’établissait à un peu moins de 8%, celui des immigrants était de 12%, montant respectivement à 39% et 21% pour ceux installés depuis moins de un an et moins de 5 ans. Pourtant l’immigration économique, donc basée sur une sélection de profil, représente la moitié des nouveaux arrivants (23200 sur 37600 en 2002).
Comme beaucoup de monde le sait désormais (c’est pas faute de le dire) au Québec, la profession d’ingénieur est à droit restreint : il faut être membre d’un ordre pour être autorisé à pratiquer comme ingénieur (et par exemple pouvoir signer des documents comme des plans). Le Québec met un effort soutenu pour faire venir des ingénieurs (qui représentent 4% des nouveaux arrivants contre 1% dans la population générale) mais ces derniers ne trouvent pas forcément de travail (79% d’activité contre 87.5% pour les natifs canadiens). De même que pour les immigrants en général, la date d’arrivée sur le territoire a un fort impact sur le niveau de chomage, ceux étant présents depuis longtemps ayant une meilleure position.
Dans le même temps de nombreuses entreprises se plaignent de ne pas avoir de main d’oeuvre qualifiée… bref, le Québec semble nager en plein paradoxe.
Quelle sont les raisons à la source de ce manque d’intérêt pour les ingénieurs (et travailleurs en général) immigrants ? La langue, autant française qu’anglaise est parfois citée comme obstacle important. La barrière culturelle est également citée bien qu’ayant un impact variable ; on peut s’interroger d’ailleurs sur le coté de la barrière qui est problématique.
Toutefois, selon les entrevues réalisées un des obstacles récurrents est la méconnaissance des diplômes et expériences étrangères. C’est malheureusement un élément contre lequel il est difficile de lutter. Plusieurs éléments sont envisageables pour inciter les entreprises à prendre des immigrants comme la diffusion d’information. Toutefois, il semble exister une dispersion au niveau des organismes et démarches à réaliser. Par ailleurs ces derniers n’ont pas de pouvoirs réels.
Beaucoup de nouveaux arrivants vont d’aide en aide, du MRCI à l’OIQ, de l’AMPE à l’OMI sans pour autant trouver de solution intéressante et dépensant parfois inutilement leur argent en équivalences inutiles. De ce fait, bien que de nombreuses aides s’offrent aux immigrants, il semble préférable de se limiter au support d’un ou deux intervenants préalablement choisis plutôt que d’aller d’organismes en organismes.
De nombreux ingénieurs étrangers se plaignent aussi du protectionnisme de l’OIQ. En effet, hormis quelques accords bilatéraux, la majorité des nouveaux arrivants doivent passer des examens théoriques, ce qui ne fait bien entendu pas sens pour des personnes ayant plusieurs années d’expérience (même des ingénieurs québécois avec de l’expérience ne pourraient pas passer ces examens). Toutefois, l’assouplissement des règles d’admission pourrait avoir pour effet pervers de faire perdre au titre d’ingénieur une certaine crédibilité auprès des entreprises. Dans ces conditions, il semble important que l’OIQ trouve une solution pour être plus ouvert aux formations étrangères sans pour autant perdre en image auprès des employeurs.
Il est également urgent pour le gouvernement de trouver une solution. En effet, alors que le Québec fait face à un vieillissement rapide de sa population et à un manque grandissant de main d’oeuvre qualifiée, la province ne peut en plus assumer les coûts liés à la non-reconnaissance des diplomes et expériences que sont le chomage, la pauvreté et le retour à l’état d’étudiant à plein temps largement financé par les caisses de l’état alors que ces mêmes personnes devraient être des moteurs de l’économie.
Divers projets comme du mentorat par des professionnels locaux ou des stages subventionnés existent déjà. L’impact mesuré est positif, cependant ces derniers ne couvrent qu’une population limitée.
De plus, à mes yeux, ces projets ne couvrent pas le problème principal qui se situe au niveau des entreprises. En effet, si la position de l’OIQ ou du gouvernement est criticable à de nombreux égards, le problème principal se situe au niveau des entreprises qui se plaignent du manque de main d’oeuvre qualifiée mais qui n’osent pas embaucher des immigrants. En ce moment j’ai l’occaison de parler régulièrement à des gestionnaires d’entreprises et c’est avec surprise que je les entends se plaindre de ce manque malgré le taux de chomage qui frole les 10%.
Si les entreprises ont effectivement besoin de personnel qualifié, que ce soit des ingénieurs ou d’autres professions, alors il y a un manque de connaissance de leur coté car des qualifications, il y en a à la pelle parmi les nombreux immigrants au chomage. Sur cet aspect le gouvernement ne peut pas grand chose puisque ses représentants sont souvent eux-mêmes peu connaissant des réalités professionnelles. Une solution envisageable résiderait donc dans une forme de lobbying auprès des entreprises pour leur faire connaître, par exemple, la qualité des professionnels français. Ceci pourrait se faire à travers les Français travaillant déjà et reconnus dans leur milieu et par des activités de type 5 à 7. Mais là encore, étant donné le nombre d’associations françaises ou francophones, chacun travaillant sur un axe particulier, ce type de démarche ne sera pas évidente à organiser.