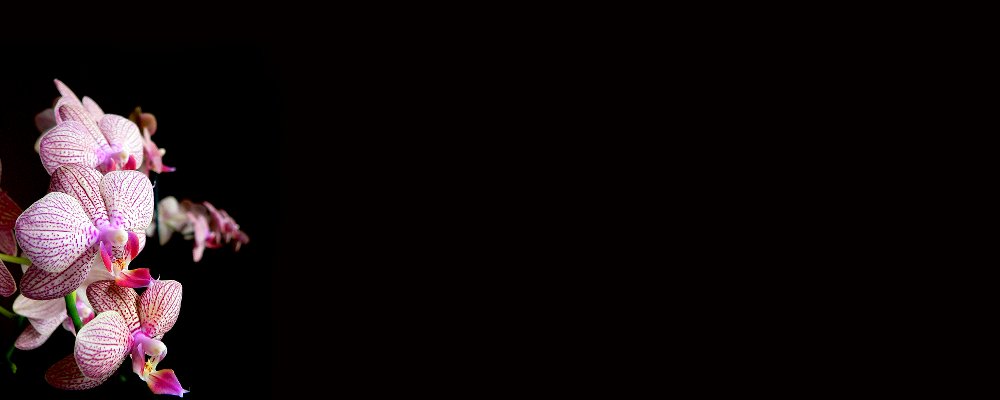Ce n’est un secret pour personne : j’adore les enfants. C’est donc sans surprise que vous apprendrez que mon stage de pédiatrie me plaît particulièrement. Mon premier coup de coeur de l’externat, même ; je commençais à me demander si j’en aurais un un jour, ou si j’étais condamnée à ne ressentir mollement que des sentiments neutres ou négatifs dans la profession que j’ai pourtant choisie. (Il faut dire qu’être externe, c’est-à-dire une sous-merde carrément exploitée, ça n’aide pas, mais c’est une autre histoire…)
Bref, j’adore la pédiatrie. Et donc, cela fait plusieurs semaines que tous les jours, du matin au soir, je pèse et soupèse le dilemme qui est maintenant le mien.
Est-ce que je veux faire cette résidence-là, oui ou non ? Pour rappel, au début de cette année, j’avais eu une longue discussion avec une résidente en pédiatrie à Sainte-Juju. Qui m’avait expliqué à quel point cet hôpital en est un qui demande beaucoup de chacun, trop même. Il ne faut pas compter les heures, ne jamais hésiter à en faire plus. Et des présentations powerpoint par-ci, et des projets de recherche par-là, en plus des activités cliniques, des gardes trop fréquentes et trop chargées. C’est pas compliqué, si tu refuses un projet de recherche, ton patron te fait la gueule pendant 6 mois après. Je ne vous raconte pas comment ils ont pris son congé de maternité…
J’en avais conclu que peu importe comment j’allais trouver mon stage, je ne devais en aucun cas ne serait-ce qu’envisager de faire cette résidence. Je n’ai pas du tout la personnalité voulue. Les journées infinies, le temps jamais compté, les plus petits détails des maladies les plus rares à savoir… Il faut vraiment être “bonne poire” pour tout accepter sans jamais se fâcher. Moi, j’aime que mes journées aient une fin, parce que j’aime avoir une vie à côté. Et j’ai besoin de pas mal de sommeil en plus.
Mais voilà, c’est vraiment le domaine de la médecine que je préfère. Je me débrouille bien avec les enfants, même les plus craintifs et braillards ; je mets les parents dans ma poche et en confiance, même les plus méfiants, même les immigrants qui ne parlent ni anglais ni français. J’aime le fait que ce soit une discipline très complète : la maladie, mais aussi beaucoup la normalité, la prévention, la guidance anticipatoire. J’aime m’adapter à chaque enfant, à son niveau de développement et aux caractéristiques particulières reliées à son âge. Etc, etc, etc.
Par contre, je ne suis pas prête à tout pour devenir pédiatre (contrairement à certains). Même en aimant ce que je fais, je bouillonne intérieurement de colère quand les journées sont trop longues ou que les sujets de mes présentations sont si pointus que je n’y apprends rien. Et je n’irai pas vivre 5 ans à Winnipeg ou Halifax, ni même à Québec ou à Sherbrooke, pour me former. Ce serait Sainte-Juju, ou rien. Je ne suis même pas en mode “machine de guerre”, je ne me fais pas plus remarquer que d’habitude et je ne lèche les bottes de personne. Je me sens juste un peu plus stressée et sous pression que dans des stages sans grand impact pour mon orientation. Bref, je n’ai pas du tout “la” technique, pour essayer d’entrer… dans une discpine où les places se comptent sur les doigts de la main et où les candidats potentiels pleuvent comme pendant Katrina.
Eh oui, car c’est là que le bât blesse : même en admettant que je finisse par me décider pour la pédiatrie en premier choix. Mes chances d’être acceptée sont pour ainsi dire nulles. Mon dossier est bon, mais n’a rien d’exceptionnel. Je n’ai pas de généreux bienfaiteur (C’est une image pour symboliser qu’il faut avoir des “poids lourds” prêts à vous rédiger une super lettre de référence, le moment venu.) pour appuyer ma candidature. J’ai même fait quelques faux pas dans mes choix d’options, par exemple. Et le pire, c’est que depuis quelques années, ils ne prennent plus les finissants de l’UdeM, leur préférant ceux de McGill ou d’Ottawa. Eux qui sont de vraies bêtes de compétition surentraînées (Avec l’ambiance qui va avec.) dans la course aux résidences. Eux dont le système de notation est plutôt favorisant par rapport au nôtre…
(Pourquoi y a-t-il si peu de places ? Eh bien, parce que le gouvernement trouve que les enfants devraient être suivis par des généralistes, car ça coûte bien moins cher au système !)
Et si malgré ces sombres prédictions, j’obtenais une place ? Ne serait-ce pas le début d’un long calvaire de 5 ans - ou même un peu plus (fellowship oblige) ? Avec quel genre de regard jaloux assisterais-je à la graduation des médecins de famille après seulement deux ans ? Avec quel genre de lassitude devrais-je mettre ma vie entre parenthèses, à un âge où l’on est justement si pressé et assoiffé de vivre ?
La conclusion de mon dilemme est sûrement qu’il faut savoir se limiter soi-même, réfréner son ambition (Et un peu son orgueil, car il faut dire ce qui est, les spécialistes ont plus de considération que les généralistes). Même si on en aurait peut-être les capacités et que sur bien des points, on aimerait sûrement ça. On ne peut pas toujours en faire plus, aller plus loin, travailler plus fort et plus longtemps. Ça fait du bien de s’arrêter aussi, un jour. Parce que vient un moment où il faut savoir choisir selon ses valeurs et son coeur, la vie que l’on veut mener. Et choisir, c’est aussi renoncer au reste.
Je ne sais pas encore si je mettrai la pédiatrie dans mes demandes de résidence. Mais ce que je sais, c’est que même si je ne le fais pas, ou même si on me refuse, ce ne sera pas une punition. À cause de la politique gouvernementale énoncée, il ne manquera pas d’enfants à suivre en médecine générale dans les prochaines décennies. (Ce n’est pas comme d’être refusé en anesthésie ou en radiologie, et se retrouver à ne pouvoir en faire d’aucune manière !)
N’empêche que le plus simple serait encore que le stage de gynéco-obstétrique me plaise autant que celui-ci. Ça permettrait de faire paisiblement la croix sur la pédiatrie : en médecine familiale, je pourrais aisément pratiquer dans ces deux domaines très complémentaires. Tout en vivant une résidence plus en phase avec ma vie.
À suivre…