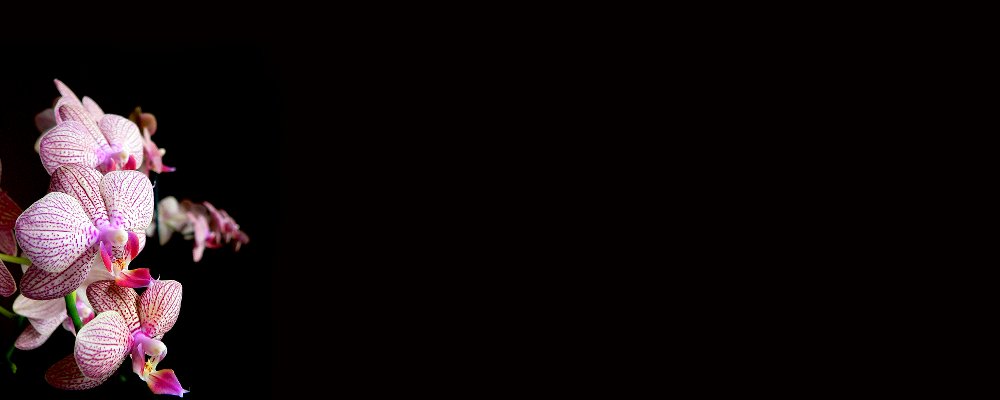Je viens de terminer un stage de pédiatrie et d’en commencer un deuxième (sur un total de quatre à faire en tout).
J’adore travailler avec des enfants et les aider, ça, je crois que vous le savez déjà. C’est encore plus agréable quand on commence à devenir bon, que les choses deviennent plus faciles, et que les patrons vous apprécient ouvertement.
En plus, j’apprivoise la tâche d’enseignement, puisque maintenant je supervise des externes, je les aide à découvrir le fonctionnement d’un hôpital et à apprendre ce qu’ils doivent savoir de majeur en pédiatrie. C’est vraiment génial et j’adore ça, même si certains ne sont pas très doués !!
Au fond c’est le même principe de guidance avec un externe qu’avec un parent à qui il faut expliquer la maladie de son enfant, ou tout simplement les étapes de son développement à prévoir dans les prochaines semaines.
Évidemment, dans mon cas, tout ceci ravive une ambivalence qui m’habitait déjà (le sempiternel “aurais-je été plus heureuse en pédiatrie ?”). D’autant plus que j’ai su entre les lignes que j’aurais été admise si j’en avais fait le choix, ce qui est évidemment flatteur et à la limite, troublant.
Mais comment vous raconter sans caricaturer le peu de vie qui me reste, le carcan dans lequel je me sens prise, l’étau qui m’étouffe, alors que ce n’est que pour quatre mois ? J’étais de garde pour 24h mardi dernier, ce samedi et je le suis encore demain. Je n’ai pas eu de week-end, sauf un vendredi soir et un dimanche soir quand j’ai fini par émerger, toute à l’envers, de mon sommeil lourd et malsain de rattrapage. Et c’est comme ça un week-end sur deux depuis trois mois. La lessive s’accumule, le frigo se vide, et la vie passe sans moi. Les couleurs sont déjà à leur apogée dans plusieurs régions, le soleil se couche de plus en plus tôt, et je ne me rends compte de rien, ou presque.
La nuit, mon attitude change du tout au tout. Je deviens aigrie, je n’aime plus rien de ce que je fais. Il faut que je me fasse une violence inouïe pour répondre aux appels et pour traîner ma carcasse jusqu’aux patients à admettre, à réévaluer. Mon cerveau s’englue, je ne pense plus bien et je fonctionne au ralenti. Et je n’ai pas envie de me doper au Guru, Full Throttle et autres boissons énergisantes.
J’ai aussi vécu de grands moments de tristesse pendant le dernier mois de pédiatrie, le jour. Le décès de deux patients (pourtant prévisible, pourtant “dans l’ordre des choses”, mais tout de même…). La confrontation avec des parents très difficiles, revendicateurs ou borderline eux-mêmes. Des expériences très fortes mais nécessaires, évidemment.
Je me rends compte que c’est davantage l’enfant et sa famille qui m’intéressent, bien plus que l’infection urinaire, la crise d’asthme ou les pelletés de laryngites que nous admettons toutes les nuits (il y a actuellement une épidémie de parainfluenza type 1 qui court en ville, vous avez dû vous en rendre compte).
Et c’est là que le miracle a eu lieu. J’ai commencé mon stage en pédiatrie du développement, où l’on évalue les enfants avec toutes sortes de retard dans leur développement, comme son nom l’indique : langage, motricité globale ou fine, sociabilisation. Je trouve ça tout à faire passionnant, pertinent et formateur pour ma future profession. Je découvre mes premiers cas d’autisme, de déficit de l’attention, etc.
Ce n’est pas encore de la pédopsychiatrie (je dois encore faire quelques mois de formation générale), mais ça s’en rapproche drôlement. Et surtout, surtout, j’adore ça, je me reconnais. Ma place n’a jamais été dans une salle d’urgence, ni dans une salle d’accouchement pour réanimer un nouveau-né de 24 semaines, ni dans une salle de soins intensifs, et elle ne le sera jamais. Ça fait du bien de s’apaiser et de découvrir que finalement, on a probablement fait le meilleur des choix.
Un seul bémol, peut-être. Le fait de constater à quel point tout le monde se fiche des enfants. À quel point ce n’est pas politique, pas vendeur et pas important de les aider avec les ressources nécessaires. Un enfant qui souffre d’un trouble de développement, plus tôt tu le diagnostiques, mieux c’est. La malléabilité du cerveau est maximale jusqu’à 3 ans et demeure assez bonne jusqu’à 6 ans. C’est donc là que tout se joue.
Comment expliquer les années d’attente pour avoir accès à tel ou tel service ? Les allègements fiscaux radins au possible pour ces familles ? Quand on sait que nos interventions de stimulation peuvent changer la trajectoire d’une vie, l’intensité d’un handicap. Ce n’est ni banal, ni anodin. C’est une catastrophe silencieuse, une autre. Dont les victimes sont les plus vulnérables de notre société, et pourtant les plus désirables à la fois.
À n’y rien comprendre, vraiment.