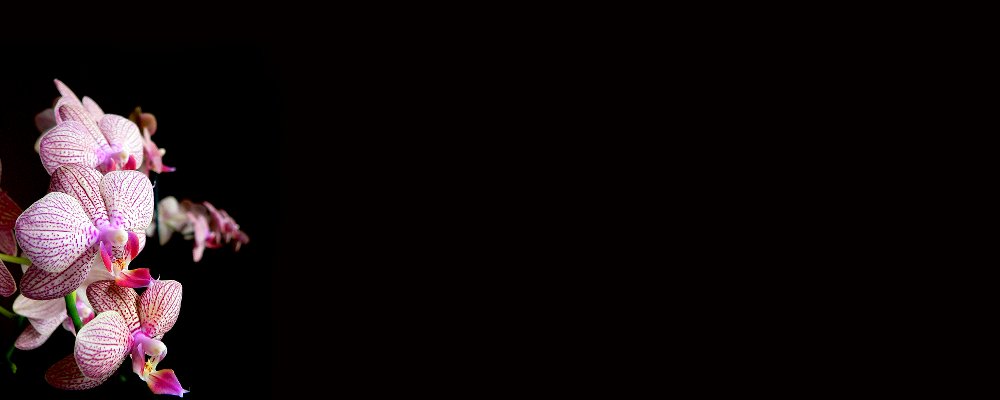J’ai entamé cette semaine mon stage de gynéco-obstétrique. Évidemment, il faut d’abord faire le deuil de mon stage précédent, de ma compétence chèrement acquise, de notre petit groupe d’externes bien soudé… Le deuil de vacances d’été étudiantes en juin-juillet aussi.
Il faut encore recommencer à zéro. De nouvelles exigences, de nouvelles personnalités, de nouvelles façons de faire. Encore un domaine où l’on est novice et maladroit, où l’on connaît fort peu de choses. Mais pour une fois, j’ai l’impression que les capacités s’acquièrent très vite pour devenir à peu près autonome. Ça va être super, les patrons vont pouvoir se servir encore plus de nous comme d’une main-d’oeuvre très bon marché ! D’ailleurs, cette semaine, ça a déjà commencé, parce que j’étais toute seule à l’urgence avec peu ou pas d’encadrement. Pff.
Un soir de cette semaine, en fin de journée, alors que le repas du midi commençait à être rendu dans les talons et que la fatigue me gagnait, on m’a demandé d’aider pour un curettage. Il s’agissait d’une patiente d’une soixantaine d’années. On lui a donné deux comprimés d’anti-inflammatoires et hop! on a procédé à l’intervention (avec une simple anesthésie locale). La dame se tordait de douleur et en pleurait, c’était une expérience assez terrible. Mon rôle a simplement consisté à lui tenir la main et à lui parler, la rassurer, lui changer les idées.
Pourtant, quand il s’agit de jeunes patientes de 15-20 ans (par exemple, les avortements), on ne badine pas avec la douleur, et l’artillerie lourde est sortie. L’intervention a lieu en salle d’op sous anesthésie épidurale, etc. On ne veut surtout pas que l’expérience soit traumatisante ou le moindrement souffrante !
Alors non, je ne comprends. La douleur d’une personne plus âgée est-elle moins pire ou moins importante ? Ne peut-elle pas aussi être traumatisante ? Ne mériterait-elle pas le même égard, dans les conditions dont nous pouvons bénéficier en 2006 en Amérique du Nord ?
Pour moi, l’aventure s’est soldée par un choc vagal. Enfin, je l’ai senti venir à temps pour m’éclipser et aller m’allonger sans tomber dans les pommes complètement ! Pourtant, je n’ai pas vu tellement de sang. J’ai surtout vu la souffrance humaine. J’ai compris que c’est elle, et non la vue du sang, qui peut me faire flancher. En salle d’op, pour l’instant, je ne me suis jamais vraiment sentie mal, étant donné que tout se passe en milieu contrôlé, avec patient correctement anesthésié, etc. Cette fois-ci, par contre, c’était différent…