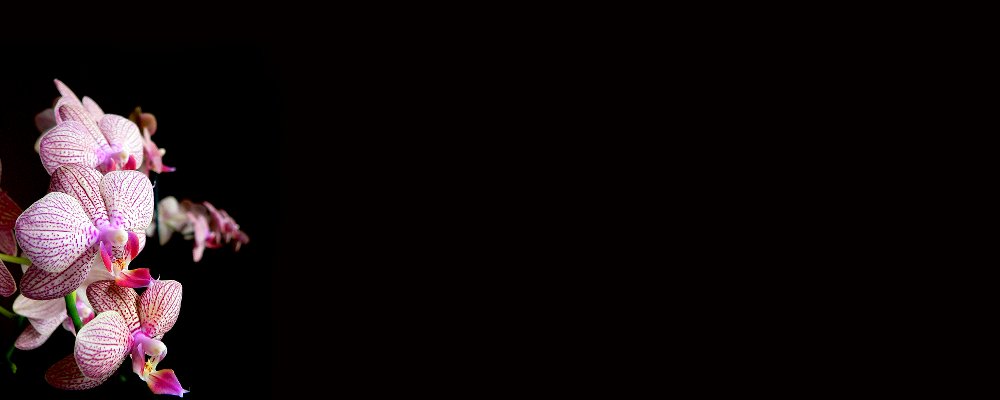A J-10 du départ, mes 2 semaines de stage à Guediawaye tirent à leur fin avec un bilan très moyen. Vivre des expériences difficiles ici était plus que prévisible et au fond, peut-être aussi plus formateur et enrichissant que quand ça se passait bien (trop facile !). Nouvelle ville, nouveau nom, j’ai ici évolué sous l’identité de Ndeye Bâ. Mais cette manie de nous donner des noms ne me plaît pas, puisque ce n’est pas moi, et que je ne peux pas changer de nom toutes les deux semaines, on est bien d’accord. Même si je sais que pour eux, cela relève sûrement du bon accueil, d’une façon de nous intégrer dans la famille. La teranga.
Côté famille, j’ai donc atterri dans cette grande famille où presque tout le monde parle bien français (bien plus que dans ma première famille), mais où il s’est avéré impossible de créer des liens, de s’engager affectivement avec qui que ce soit. C’est une famille qui a déjà accueilli un nombre incalculable de stagiaires et qui en est maintenant complètement blasée et désabusée. D’ailleurs, dès le soir de mon arrivée, j’ai eu droit aux fameux reproches pour ceux qui m’ont précédés : ils gardent mal contact, ne reviennent pas visiter, arrêtent d’appeler ou d’écrire, etc. Donc sous des dehors de gentillesse, de salutations, de sourires et de blagues, sous le superficiel, je n’ai rien trouvé du tout, rien vécu. C’est dommage, mais en même temps pas catastrophique. Je n’ai pas été maltraitée, on n’a pas été méchant avec moi. Peut-être qu’au fond, la faute me revient aussi en partie. Peut-être ai-je laissé mon cœur dans l’autre famille, et certainement je suis arrivée dans une mauvaise phase, déprimée et gavée des aspects désagréables du Sénégal.
Maintenant mon moral est revenu au beau fixe, mais il reste toujours un agacement face qu comportement des gens. Je ne peux m’empêcher de le voir avec mes lunettes culturelles, et pour moi leur façon de m’aborder est toujours grossière et impolie, me crier par la tête, me taper dessus, me crier « toubab », me faire des déclarations d’amour au premier coup d’œil, etc. Je n’y peux rien, j’ai beau raisonner que pour eux c’est normal, pour moi ça ne l’est pas. Parfois, selon l’humeur du moment, je réponds à la blague. Mais de plus en plus souvent, je réponds en ignorant, tout simplement. Je ne suis pas un jouet, je ne suis pas obligée de m’approcher de tout le monde pour leur permettre de se moquer de moi, et je ne suis pas obligée non plus de serrer les mains de tous les inconnus, surtout les enfants, des mains pas lavées très souvent et souvent très sales… C’est se respecter soi-même que de ne pas toujours s’obliger à faire ce qui nous répugne. Il faut bien se préserver un peu ici, car on est à la merci des Sénégalais 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Le temps passant, le naturel revient évidemment, on ne peut pas le réprimer sur une si longue période, la nouveauté passée, et il m’est de plus en plus difficile de supporter la vie africaine avec toujours plein de monde dans la chambre, pas la moindre intimité, tout le monde le nez fourré dans mes affaires, utilisant mes produits, buvant mon eau, etc. Moi qui ai tant la hantise des germes, des poux, etc. Moi qui suis de nature solitaire, possessive, individualiste. Au moins on pourra dire qu’ici ma vraie nature s’affirme et que je n’en ai même plus honte. Je suis comme ça et pas autrement, c’est tout.
Côté stage, j’ai pu expérimenter les désillusions, les déceptions, les frustrations à souhait. Au moins, quand on fait le boulot de médecin, on est certain d’être toujours utile. Un abcès drainé est un abcès drainé, un palu soigné est un palu soigné. Evidemment, quand on se prend à réfléchir en amont, à tout ce qui pourrait être évité avec de l’hygiène, de la prévention, des mesures de sécurité, des vaccins et un filet moustiquaire pour tout le monde, on est vite découragé par l’ampleur de la tâche, pas l’immobilisme local, par la fameuse résistance au changement dont Hoedic m’avait si bien entretenue. Elle est là, partout, et ici plus que jamais, je m’y suis butée.
Je n’ai pas beaucoup travaillé ici parce qu’un groupe de femmes, au fond, ce n’est pas très violent. Ca papote, ça roupille, ça grignotte, ça fait de la teinture (d’ailleurs j’ai acheté sous vente forcée une jupe ici), mais ça ne travaille pas beaucoup. Ma collègue de travail principale aura été ma mère de famille ici. Mes tâches auront consisté, bien simplement et humblement, à effectuer des visites à domicile avec elle (intéressant de jeter un coup d’œil curieux dans des intérieurs divers, dont certains plutôt pauvres…), à prendre des dizaines et des dizaines de tensions artérielles pendant des séances de « sensibilisation » (il m’en reste une ce soir, puis ma tâche ici sera terminée et je rentre à Dakar demain) et à faire des séances « causeries » de pesées d’enfants. Comment des choses aussi basiques ont-elles pu engendrer autant de frustration ?
Par le fait que tout est surfait, superficiel, et pour ainsi dire, inutile. Les mots sensibilisation, causerie et micro-crédit (en fait une loterie !) sont totalement usurpés, utilisés à outrance mais vides de sens quand on assiste ensuite à la réalité qu’ils dépeignent. Les différents actes sont réalisés dans une optique de valorisation (car ma mère de famille en est très fière, ça oui), mais complètement vides d’intérêt car sans intelligence derrière. Le dépistage de tension artérielle est fait sur des populations absolument mal ciblées, un groupe de bonnes femmes qui se rencontrent surtout pour le plaisir et pour leur loterie (pardon, « micro-crédit »), mais trop jeunes pour faire tellement d’hypertension. Où sont les vieux, où sont les femmes ménopausées, où sont les hommes ? Les gestes de prise de tension sont mal réalisés, avec une absence totale d’ouverture et d’intérêt devant mes commentaires, pourtant respectueux, pour leur montrer la bonne façon de faire. Il n’y a aucun échange, personne ne m’écoute. Ils ont plutôt l’impression que c’est à eux de m’apprendre des choses !
De même, pendant les visites à domicile et les pesées, la procédure prend le pas sur le fond. On note des poids à tout hasard, sans les réfléchir sur une courbe de poids, en fonction de l’âge. Il est totalement vain de faire tout ce travail de notation de poids en petites colonnes si on n’utilise pas ensuite sa tête pour en penser quelque chose et agir en conséquence. Par exemple, après la séance de pesées, où j’ai constaté qu’aucun enfant de ce coin de quartier n’était malnutri, certains étant même obèses, ils ont décidé de faire l’enseignement de la fameuse boisson énergétique à base de lait, d’huile et de sucre (que j’avais souvent prescrit à Sendou aux enfants qui ne grandissaient pas bien). Le seul petit, minuscule hic, c’est que c’était utilisé à mauvais escient, personne dans la salle n’ayant besoin de ce breuvage. Pire, ils ont même osé me dire que c’est bon aussi dans les cas de diarrhée, ce qui est complètement faux ! Le breuvage de la diarrhée (contre la déshydratation aiguë), c’est les sels de réhydratation orale de l’OMS ou une recette reproductible à base de sel, de sucre et d’eau, qui apparaît sur tous les carnet de santé des enfants ici. J’ai eu beau expliquer cela à tout le monde, je me suis heurtée à un mur et j’ai reçu une brique sur la tête.
Sinon, en général, ça fait 3 fois qu’on me propose des bébés, alors Hoedic, je ramène trois petits Noirs avec moi dans les bagages. Pensez-vous que les douanes vont me poser problème ? Je ne suis presque plus capable de manger du poisson et du riz trop huileux, trop salés et trop pimentés, et presque plus capable d’affirmer à tous ceux qui me le demandent que j’aime ça. Je suis aussi fatiguée de faire ma lessive à la main deux fois par semaine, j’ai hâte de retrouver la civilisation et de m’émerveiller devant une machine qui fait tout le travail à ma place. Presque plus capable non plus je suis de porter toujours les quelques mêmes habits que j’ai apportés (croyez-moi, ils ne sont pas nombreux), additionnés des quelques-uns que je me suis fait faire ici.
Plus le temps passe et plus il fait chaud, avec l’avancement dans la saison des pluies. Plus il y a d’insectes avec lesquels cohabiter, aussi. Je n’arrive pas à décider ceux que je trouve les pires, des mouches noires qui sont posées sur soi à longueur de journée et aussi sur ce qu’on mange (on les enlève de la bouchée que l’on s’apprête à prendre, et c’est le seul pouvoir dont on dispose), ou les moustiques redoutables surtout à Dakar, potentiellement porteurs du paludisme et qui laissent invariablement un souvenir enflé, rouge et qui démange. Sans compter les affreuses coquerelles propres à couper l’appétit de n’importe qui sauf les Sénégalais, et les petites choses diverses et variées qui se glissent dans les vêtements, dans les sacs, dans les bouteilles d’eau, partout finalement.
Tout va quand même bien et mon moral est au beau fixe. La semaine prochaine, de nouveaux défis à relever m’attendent. Je serai à Dakar, j’espère affectée dans un service hospitalier pour voir comment ça s’y passe, comment les patients sont traités, etc. Je devrai apprendre à me déplacer dans leurs transports bondés, sur des routes enlisées dans un trafic sans nom, dans des odeurs par moments à peine respirables. Le tout seule pour me retrouver, pour affronter les attitudes difficiles auxquelles on se heurte sans cesse. Je dois avouer avoir un peu peur de tout ça, surtout avec mon absence complète de sens de l’orientation.
Mais on verra bien, inch’Allah, n’est-ce pas…