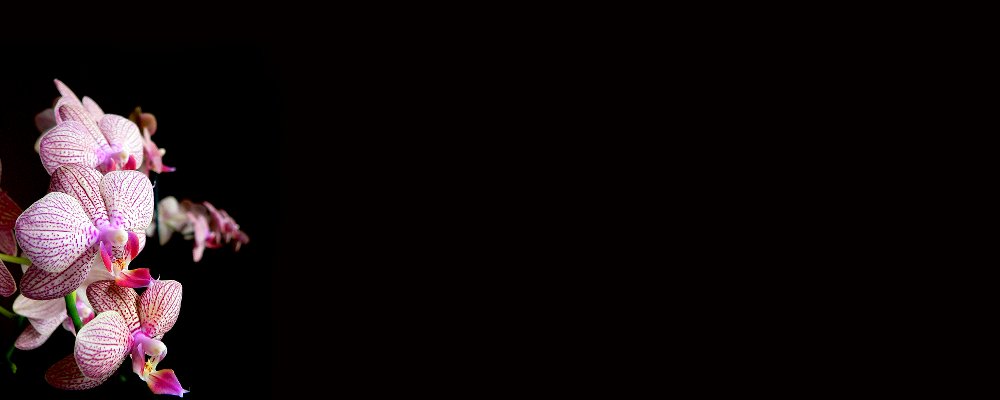Poursuivant mon rattrapage de lecture -au détriment de mon sommeil, je suis passé au travers de l’essai Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles. Le titre m’a fait repousser sa lecture bien que les essais d’Atelier 10/Nouveau Projet soient toujours porteurs de messages forts. Après Second début, qui traitait du retour nécessaire du féminisme, voici donc le pendant traitant du rôle de l’homme.
Steve Gagnon soulève avec un certain lyrisme toutes les tares qui pèsent sur les épaules des hommes, et plus encore des adolescents. Si le féminisme a des objectifs a priori assez clairs, la définition des problèmes des hommes est plus épineuse, plus souterraine, à la manière dont la gente masculine tend à enterrer ses états d’âmes le plus profond possible pour ne plus en entendre parler. Cliché? Peut-être. Pourtant à lire la description que donnent des ados de la virilité, clichés et réalités ne se confondent que trop bien.
Une courte lecture recommandée à tous les hommes, bonus supplémentaire aux pères de garçons (avec 3 chez moi, je devrais pouvoir le relire encore quelques fois.)
Ce livre, bien involontairement, m’a replongé dans un des épisodes les plus humiliants de mon adolescence. Pas l’humiliation superficielle de celui qui prend un vent en public ou se fait tabasser à la sortie de l’école. L’humiliation profonde, celle qui change la perception qu’on a de soi-même, dans la mauvaise direction.
Je devais avoir 16 ans et passais un temps significatif à mes entrainements de natation; sans aucun espoir d’atteindre ne serait-ce qu’un niveau national, c’était un élément important de ma vie. Un jour, le club nous annonce qu’il peut former gratuitement 3 membres de l’équipe comme maitre nageur (formation d’une valeur de 2000 francs) et que les personnes formées pourrons ainsi donner des cours aux plus jeunes et avoir un petit salaire. Mes deux meilleurs amis et moi-même posons notre candidature: nous sommes les meilleurs du club et les plus vieux, nous sommes les trois seuls titutlaires d’un dauphin d’or, niveau le plus élevé pour le sauvetage, nous sommes certains d’être les heureux élus.
La semaine suivante, nous apprenons que les sélectionnées sont trois copines de 3 ans nos cadettes, techniquement relativement moyennes en natation. Lorsqu’avec mes amis nous demandons des explications, la réponse est simple, directe, cassante: les garçons sont moins matures que les filles. Il fallait croire qu’un écart de trois ans justifiait encore de prendre les filles.
La vérité était bien sûr toute autre: le père d’une des trois filles était président du conseil d’administration du club. Il a du se dire que s’il se cassait les couilles dans ce rôle, il pouvait bien obtenir quelques passe-droits pour sa fille et ses copines. Nous le savions bien à l’époque, mais l’argument servit pour justifier le choix n’en était pas moins ravageur pour nous; pour moi du moins.
Je me rappelle m’être retrouvé dans les vestiaires avec mes amis et avoir dit quelque chose comme “ils veulent qu’on ne soit pas mature, on va leur montrer”. Et s’en sont suivis plusieurs conneries bien senties comme peuvent en faire des petits cons en quête de revanche.
Est-ce que les garçons sont immatures? C’est ce que mentionnent plusieurs adolescentes interrogées dans le cadre de l’essai de Steve Gagnon. Chose certaine, je l’étais. À l’époque je me pensais précoce parce que j’avais fait ma puberté tôt, j’étais grand et les choses avaient fait que j’avais acquis une liberté d’action assez importante dès l’âge de 13-14 ans.
Dans les faits j’étais indolent, superficiel et je passais le plus clair de mon temps libre à glander ou regarder des émissions de télévision que je trouvais moi-même chiantes. Sauf quand il s’agissait d’aller nager ou de faire des choses dangereuses comme plonger du haut d’une falaise.
Comme l’explique l’essai, il est du devoir des hommes d’aider les garçons à se trouver. Je continue à croire que nous aurions été de bons maîtres nageurs: la piscine était notre deuxième maison et toute occasion pour nous retrouver ensemble était bonne -bien que la majorité du temps nous étions trop feignants pour nous retrouver hors des entrainements. Un peu de reconnaissance aurait surement fait le travail pour un certain temps, probablement plus que les filles choisies qui se sont rapidement trouvé une autre activité. Au lieu de ça, nous avons continué à fomenter des mauvais coups pour nous confirmer et autres que nous étions effectivement immatures.
Je nous souhaite d’être solidaires envers ces adolescents perdus qui cherchent comment devenir les humains nobles et flamboyants qu’ils ont encore l’espoir d’être, puisque c’est notre responsabilité de les tenir à l’écart des garde-robes de sous-sol où ils ont tendance , trop souvent, à s’attacher le cou.
Steve Gagnon, Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles.